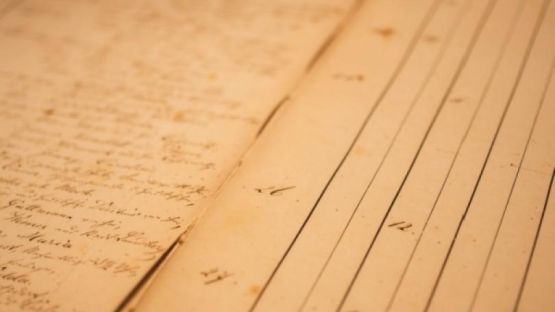Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !
La charte du cotisant contrôlé a récemment été mise à jour, notamment s’agissant de la prolongation de la période contradictoire. Quelles sont les conséquences de ces changements de forme sur le cotisant ? Focus.
Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles ! - © Copyright WebLex
mercredi 28 août 2024
Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !
Récemment, les modalités concrètes de mise en œuvre du parcours de soins coordonné des enfants et des adolescents protégés ont été arrêtées. L’occasion de revenir sur ce dispositif….
Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !
Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.
Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.
La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.
Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).
Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€.
Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ ! - © Copyright WebLex
mercredi 28 août 2024
Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ?
Depuis 2015, les réparations automobiles ne se font plus obligatoirement avec des pièces neuves. Afin de promouvoir les produits issus de l’économie circulaire, cette pratique s’étend, notamment aux 2 et 3 roues…
Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles
Depuis 2015, lorsqu’un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.
Afin de promouvoir de dispositif d’utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d’autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.
Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :
- les pièces de carrosserie amovibles ;
- les pièces de sellerie ;
- les vitrages non collés ;
- les pièces optiques ;
- les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :
- des axes des roues ;
- des garnitures de freins ;
- du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
- les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, et notamment lorsque :
- les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d’un rappel ou dans l’exercice d’une garantie ;
- des pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
- le professionnel estime que l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire présenterait un risque pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ? - © Copyright WebLex
mercredi 28 août 2024
Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Parce que ce registre est aussi un outil pour les entrepreneurs, le Gouvernement a fixé les modalités de délivrance des attestations d’immatriculation. Faisons le point.
L’attestation d’immatriculation : des conditions de forme à respecter !
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA).
Géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.
Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées :
- au registre national des entreprises (RNE) ;
- le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l’activité, à savoir :
- au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’activité est commerciale ou pour les sociétés ;
- au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.
Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l’INPI de l’attestation d’immatriculation du RNE.
D’abord, notez que seul l’INPI est compétent pour délivrer ce type d’attestations.
Ensuite, l’attestation doit respecter les conditions suivantes :
- elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
- elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
- elle indique l'état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
- elle comporte la Marianne de l’INPI en filigrane et le logo de la République française ;
- elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
- elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise qui permet la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.
Enfin, cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.
Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles - © Copyright WebLex
mardi 27 août 2024
Déclaration de créance dans une procédure collective : gare au déclarant !
Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l’exploitant ? Réponse du juge…
Déclaration de créances : au nom de qui ?
Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.
Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d’une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.
Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l’EIRL, représentée par l’exploitant.
Pour rappel, l’EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d’affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d’affectation, classiquement la résidence de l’exploitant, sont alors protégés.
Cependant, l’EIRL n’est pas une société, par conséquent elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.
Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l’EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n’a pas de valeur et la créance est rejetée.
« À tort ! », se défend l’exploitant qui rappelle que la loi lui impose d’utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S’il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu’elle est faite pour son compte.
Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l’entrepreneur.
Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l’EIRL n’existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d’exister et d’exercer leurs activités.
mardi 27 août 2024
Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !
Après avoir acheté auprès d’une société des panneaux photovoltaïques, un couple, très mécontent de son achat, demande au juge l’annulation de son contrat avec la société vendeuse. Une action en justice impossible en vertu de la loi, selon la société, puisqu’elle est à présent en liquidation judiciaire. Sauf que la loi ne suspendrait pas, selon le couple, tous les types de poursuites…
Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?
Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.
Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !
Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.
Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !
Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :
- sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
- la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :
- soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
- soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.
Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…
« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.
Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.
Par conséquent, le procès aura bien lieu…
Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) ! - © Copyright WebLex
mardi 27 août 2024